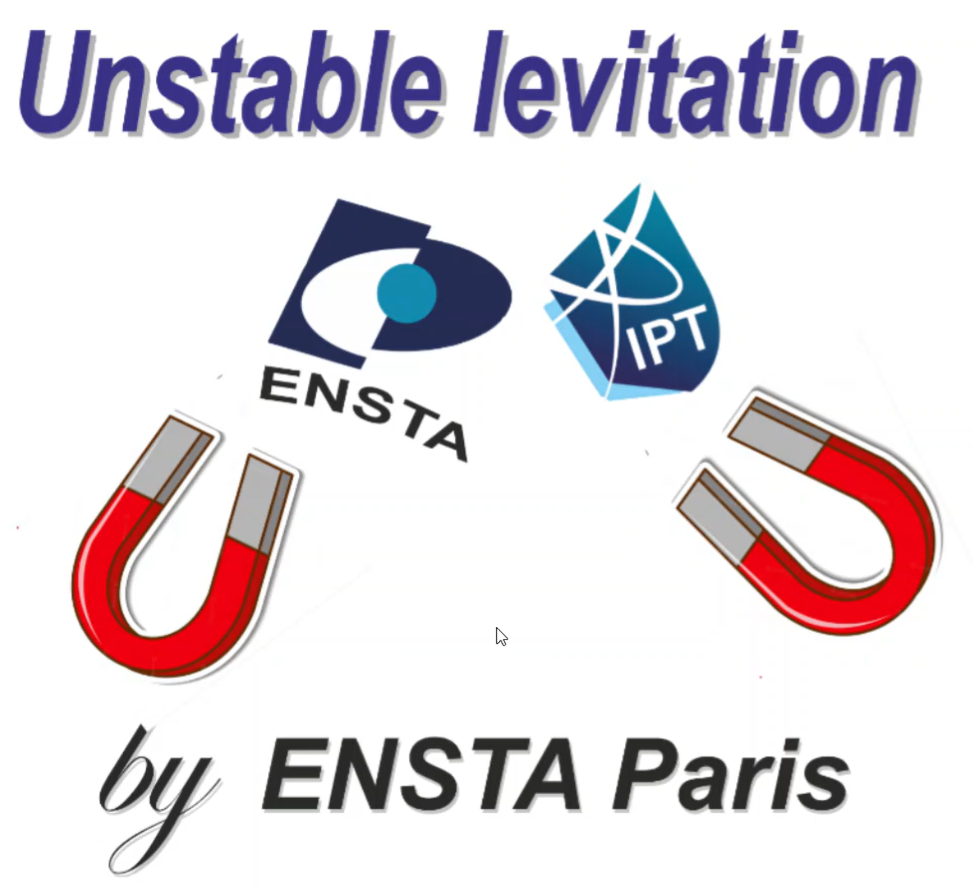Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet de l'IPT (International Physicist Tournament) sur la lévitation instable. Le sujet était le suivant : est-il possible de faire léviter un aimant de façon stable sans supraconducteurs ou d'autres systèmes de contrôle bien connus. Le sujet nous demandait également de nous intéresser aux limitations du mode de lévitation étudié, et d'évaluer la possibilité de faire léviter deux aimants en même temps avec ce mode de lévitation, à condition que ces aimants ne se touchent pas.
Voici un rapide récapitulatif du déroulement de la présentation : on va commencer par présenter quelques façons connues de faire léviter un aimant ; ensuite on va s'intéresser à un nouveau type de lévitation magnétique, en en donnant une description théorique et également en montrant des expériences illustrant ce phénomène de lévitation.
Le mode de lévitation le plus connu est sûrement celui de la lévitation par supraconducteur. On refroidit une pièce de céramique que l'on place au-dessus de plusieurs aimants. Sous une certaine température, le matériau diamagnétique va rejeter les lignes de champ magnétique qui vont faire une sorte d'effet « coussin » sous la céramique qui va lui permettre de léviter.
Voici un autre type de lévitation. En bas à droite, on voit que la situation est constituée de deux aimants, formant un quadrupôle magnétique. Si on regarde la vidéo, on voit que l'on a une balle qui est piégée dans une sorte d'hyperboloïde. En fait, c'est la rotation de ces deux aimants qui va former un point selle (l'analogie de la vidéo est faite avec l'énergie potentielle de pesanteur) dont la rotation permet de piéger l'aimant qu'on placerait au-dessus.
Le mode de lévitation que l'on va présenter a été découvert par un physicien turc nommé Hamdi Ucar, et son article a été le point de départ de tous nos raisonnements sur la théorie de ce phénomène de lévitation. Comment ça marche ? On a deux aimants : un aimant appelé rotator qui va tourner dans un plan, et un aimant qu'on appelle le floator qu'on va placer au-dessus du rotator. Le floator est alors soumis à un champ magnétique tournant et variable, et ainsi on va mettre en évidence théoriquement que, sous l'effet d'une force magnétique, il pourra léviter au-dessus du rotator.
On observe expérimentalement que, lorsque ce mode de lévitation se produit, le floator entame un mouvement de précession autour de l'axe de roation du rotator, et que la vitesse angulaire de cette précession semble être égale à la vitesse de rotation du rotator. C'est une considération fondamentale qui nous aidera grandement dans la mise en place de la théorie du phénomène par la suite, et ainsi on voudrait être capable de l'expliquer d'un point de vue théorique. Pour ce faire, on projette le mouvement du floator dans le plan x=0, comme indiqué sur le schéma. En projetant le champ magnétique tournant du rotator dans ce plan, on obtient un champ magnétique variable selon une dimension. Celui-ci possède une composante dynamique et une composante statique, et cette dernière provient d'un choix fondamental guidé par l'expérience, sur lequel nous reviendrons par la suite. On projette également le moment magnétique du floator et on obtient une sorte de mouvement de bascule à deux dimensions, dont l'angle par rapport à l'axe z, que l'on appelle phi, est variable au cours du temps. C'est donc la manière dont évolue phi que l'on cherche à caractériser.
On peut alors calculer le moment magnétique généré par le champ du rotator, et par le théorème du moment cinétique, on obtient alors l'équation d'évolution de l'angle phi. Dans l'approximation des petits angles, licite selon les relevés expérimentaux fournis dans l'article d'Hamdi Ucar, on reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique forcé à la pulsation omega, qui est la même que celle du champ magnétique tournant ! On a ainsi montré que le floator tourne autour de l'axe z à la même vitesse angulaire que le rotator, et effectue un mouvement de précession. En effet, la projection d'un tel mouvement du floator dans le plan x=0 donnerait exactement un oscillateur forcé.
Ayant établi cela, il est licite de se placer dans le référentiel tournant constitué par le plan, contenant l'axe z et commun au floator et au rotator. Avec les expressions des moments magnétiques du rotator et du floator, on peut calculer la force exercée par le rotator sur le floator en considérant une interaction dipôle-dipôle. Remarquons que la composante de cette force qui s'oppose au poids, nécessaire à la lévitation, serait nulle sans l'existence d'un angle constant gamma, représenté sur le schéma, entre le moment magnétique du rotator et le plan dont un vecteur normal est le vecteur de rotation du rotator. Autrement dit, le rotator est légèrement incliné selon la verticale, ce qui a pour effet de générer la composante statique du champ magnétique selon la verticale que nous évoquions précédemment. Ceci est une considération expérimentale fondamentale que nous a souligné Hamdi Ucar, et qui nous a permis de réaliser ce phénomène de lévitation. En effet, nous avions de prime abord réalisé l'expérience sans cet angle gamma, et nous ne parvenions pas à obtenir ce mode de lévitation.
Après quelques calculs, on obtient l'expression de la force magnétique subie par le floator. On constate alors que l'équilibre avec le poids, une force proportionnelle à 1/z
2, est possible. Ceci est également illustré par le fait que la force est conservative, et que l'énergie potentielle associée présente bien un minimum.
Une autre configuration qui permettrait la lévitation magnétique ce serait de ne pas incliner l'aimant du bas, le rotator, mais de décaler légèrement le centre de rotation, et en refaisant les calculs avec l'offset, epsilon, qui est le décalage de l'aimant du haut par rapport à l'axe de rotation, on constate qu'on met encore en évidence une force qui permet d'obtenir un équilibre. En réécrivant l'expression de la force, on obtient une expression qui ressemble à la force puissance trouvée précédemment avec un terme d'offset. Cela conclut la partie théorique de notre exposé. Pour récapituler, on a mis en évidence que si on avait un offset ou une inclinaison du flotator, on pouvait avoir lévitation du flotator.
Pour la configuration expérimentale, on a imprimé en 3D des têtes qui supportent les aimants cubiques à mettre dans la dremel qui a tourné à environ 10000 tours par minute. L'avantage de ces têtes est qu'elles permettent d'éviter que les moments des deux aimants s'alignent. C'est un problème qu'on a rencontré avec d'autres dispositifs expérimentaux. L'avantage de ces encoches cubiques est qu'elles permettent d'encastrer l'aimant dedans et d'éviter un retournement de l'aimant. La partie la plus subtile dans la partie expérimentale était de trouver la bonne inclinaison qui permette d'avoir la lévitation et de trouver le bon offset également. Il fallait donc trouver un équilibre entre l'angle et l'offset car la lévitation n'est pas possible pour tous les angles. Pour récapituler, voici les angles que l'on a utilisé. Dans la configuration où la dremel est en bas et on place l'aimant en haut, un angle de 3 à 5 degrés suffit. L'inclinaison peut être moindre car la composante selon z de la force attractive peut être plus faible. Par contre, quand on retourne la dremel, dans la configuration des vidéos, on a besoin d'un angle plus fort car on a besoin d'avoir plus de force attractive pour permettre au flotator de léviter. Pour ce qui est de l'offset, on a utilisé un offset qui vaut environ 1 dixième de la taille de l'aimant et un inclinaison de 4 degrés on a pu observer la lévitation magnétique. L'angle utilisé peut être plus faible grâce à l'offset. On peut voir que la configuration de la lévitation est assez instable. On observe la lévitation magnétique. On a ralentit la vidéo à 800 images par seconde. Une des expériences que nous aurions voulu réaliser est de mesurer la vitesse de rotation du flotator et de la comparer avec celles du rotator. On ne la pas fait car la manipulation est assez compliquée et par manque de temps. On avait pensé à utiliser un tachymètre laser pour effectuer cette mesure. Pour conclure, un des objectifs du problème était de savoir s'il était possible d'avoir la lévitation avec 2 aimants. On ne l'a pas fait car c'était déjà très compliqué d'obtenir la lévitation à l'envers. Pour ce qui est de la lévitation avec 2 aimants, on a vu dans l'article de Monsieur Umcar que c'était possible parce qu'en fait on a différents points d'équilibre lors de la rotation du rotator qui permettent d'avoir la rotation du flotator. Il faudrait donc placer le rotator à ces endroits pour avoir la lévitation.
Voilà, c'était notre présentation pour la lévitation magnétique. On a pris beaucoup de plaisir à réfléchir dessus car c'était une vraie initiation à la recherche, il y a eu tout une phase de lecture d'article et de compréhension du phénomène. On a également eu une discussion très intéressante avec Monsieur Ucar pour avoir plus d'informations.